J'ai eu le plaisir de recevoir Marc Villard à la médiathèque il y a quelques mois, où on organisait une manifestation jazz & polar. Bien-sûr, on a parlé de plein d'autres choses, le travail d'écriture, le roman noir, les nouvelles.... Le bonhomme est passionnant et plein d'humour (au bout d'un moment, j'ai renoncé à indiquer "rires dans la salle" dans le texte qui suit, il en aurait été truffé !), et ce fut vraiment une chouette rencontre, dont je retranscris ici de larges extraits. Bonne lecture.
 © Ramor
© Ramor
Bienvenue, Marc Villard. Vous avez écrit des romans, de nombreux recueils de nouvelles, des scénarios, pour la télévision, la BD, des romans pour la jeunesse... Seriez-vous un "graphomane" ?
Il y a beaucoup d'écrivains de ma génération qui ont commencé à écrire à la trentaine, en profitant d'un moment entre deux jobs, ou même quand ils étaient au chômage. Mais pour ma part, j'ai commencé à écrire tôt, à l'âge de 19 ans, alors au fil des ans ça s'accumule.
Vous avez commencé par écrire de la poésie, presque exclusivement pendant une dizaine d'années, publiant même un recueil au début des années 70.
En 71, oui. En fait, je faisais des études à l'école Estienne, et comme la plupart des garçons de mon âge qui faisaient des études d'arts graphiques, je pensais que je pouvais devenir peintre. Puis rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Mais j'avais toujours envie de raconter quelque chose, de transmettre, de créer, mais je savais que ça ne passerait pas par la peinture. Et j'ai commencé à écrire de la poésie.
Je n'ai pas fait d'études universitaires, et la fiction avait quelque chose d'impressionnant, il y avait tout un corpus littéraire assez pesant, et je ne me voyais pas partir dans la fiction comme ça. Alors j'ai commencé doucement par la poésie. A cette époque, j'étais un lecteur d'Eluard, de René Char... On était dans les années 60.
C'est la rencontre avec le polar qui vous a décomplexé par rapport à la fiction, à ce corpus littéraire pesant et intimidant dont vous parlez ?
Plus tard, oui. C'est à dire que quand j'ai commencé à écrire, la révélation d'une poésie à laquelle je pouvais m'apparenter est venue des poètes beatniks américains, toute la génération de Ginsberg, de Kaufman, Kerouac... C'était une poésie qui sortait de l'aspect très confiné, très introspectif aussi, de la poésie française de l'époque, pour aller vers une poésie d'aventure, et assez narrative aussi, ce qui m'a plu et enthousiasmé... Pendant longtemps, j'ai animé et participé à des revues de poésie.
La fin des années 60, c'était une période propice ?
Oui, après 68, au-delà d'un mouvement politique fort, il y a eu aussi un mouvement culturel important, assez marginal, qui passait notamment par la première mouture du magazine Actuel, qui a été repris après par Jean-François Bizot. C'était un lieu où on se croisait beaucoup, et une période effectivement assez propice à créer, à faire des choses.
Pour en revenir au polar, je l'ai découvert... c'est une anecdote en fait, on en a tous une comme ça... J'étais en vacances en Bretagne et il pleuvait, ce qui est assez rare quand même (rires), avec mes parents, j'avais 13 ans, et comme je m'ennuyais beaucoup, je me suis réfugié dans le grenier de la maison qu'on louait. Il y avait tout un tas de livres entassés qui étaient de vieux Série Noire, cartonnés, couverture jaune et noir. Je ne connaissais pas du tout, et je me suis précipité là-dessus. Et comme la pluie a duré longtemps j'ai lu beaucoup (rires dans la salle). Des polars américains. Et j'étais fasciné par ce monde que je connaissais pas, qui montrait l'Amérique des perdants, des détectives privés... Et puis, sur le plan littéraire, il y avait l'introduction de mots complètement magiques comme « Snack-bar », « Rodéo drive », etc... Et surtout, j'ai été très marqué par la littérature américaine sur un plan phonétique.
Vous vous rappelez de ces "auteurs du grenier" ?
Des gens comme Day Keene, Harry Wittington, William O'Farrell, des seconds couteaux de la Série Noire, quoi...
Chez vous, il y avait des livres ? Est-ce que vos parents lisaient ?
Non, non. Mes parents ne lisaient pas. Je suis issu d'un milieu assez modeste où effectivement, bon, on ne lisait pas, sauf le journal que lisait mon père. Je n'avais pas la télévision parce que je faisais partie d'une famille qui partait du principe que tant que j'irai à l'école, il n'y aurait pas de télévision. On n'avait pas de téléphone non plus. C'est marrant d'ailleurs, parce que quand on dit ça maintenant, on a l'impression qu'on parle du 18ème siècle, mais c'est pas si vieux que ça...
On parlera un peu plus tard de vos liens avec le jazz, mais vous avez commencé par écouter du rock, et avez joué aussi de la batterie dans un groupe.
Je fais partie d'une génération qui a grandi avec le rock ; étant né en 1947, j'étais aux premières loges. Une musique facile pour moi qui étais un gosse de banlieue issu d'un milieu modeste, n'ayant pas des parents qui m'emmenaient à des concerts de musique classique etc... On écoutait plutôt André Verschuren. Mais bon, ça me va très bien, je n'aime pas trop la musique classique.
Donc, oui, j'ai grandi avec ça, le rock américain, français, j'ai joué de la batterie - ne sachant pas la musique ! - dans les années 60. Et puis en même temps, il existait une espèce de passerelle entre le rock, des émissions comme Salut les copains produite par Frank Ténot et Filipacchi qui animaient en même temps le soir une émission qui s'appelait Pour ceux qui aiment le jazz. Et je me suis donc mis petit à petit à écouter autre chose que du rock. Maintenant, j'écoute du jazz en priorité, mais toujours un peu de rock.
En 1981, vous publiez successivement un recueil de nouvelles, votre premier roman et un scénario de film. C'est une date charnière, un tournant vers la fiction alors que vous écriviez essentiellement de la poésie jusque là ?
Quand on écrit de la poésie, c'est qu'on a quelque chose à communiquer, c'est un espace extrêmement ouvert et qui permet quand même à n'importe qui d'écrire. C'est de l'ordre du ressenti, de l'épidermique.
J'en ai écrit pendant 10 ans et m'en suis servi comme auto-analyse, ce qui permet de faire des économies ! Puis au bout de 10 ans, j'ai eu le sentiment d'en avoir fait le tour, à tort ou à raison d'ailleurs. Donc, je n'avais plus envie de continuer à écrire de la poésie, mais par contre j'avais envie de continuer à écrire. Autre chose. Du coup, comme j'étais un lecteur de polars, je me suis dis tiens, je vais écrire ça.
Influencé notamment par le polar américain, donc ?
Oui, j'avais envie d'écrire du roman noir, tout simplement parce que les livres américains que je lisais à cette époque-là, étaient l'essence même du roman noir, les Hammett, Chandler, Burnett, McCoy etc..., parlaient d'hommes qui partaient en guerre contre l'Etat, contre les villes aux mains de la pègre. On parlait de journalistes qui essayaient de dire la vérité et se retrouvaient avec une balle dans la tête, de jeunes qui partaient à Hollywood et qui ne gagnaient jamais la partie, enfin bref, c'était quand même assez social, c'est ça qui me plaisait, cette littérature sociale, de lutte, écrite comme pouvaient l'écrire des journalistes, très factuelle, avec une grande économie de moyens et en même temps très précise. Tout me plaisait là-dedans et c'était vraiment ça que j'avais envie de faire.
Concernant la nouvelle, je peux m'expliquer facilement. J'étais habitué depuis des années à écrire court, serré et en plus ayant un goût, comme je viens de le dire, pour une écriture sèche, dégraissée, le contraire d'une écriture fictionnelle lourde avec de longs développements, dès qu'il y a un type qui se lève et qui va chercher son manteau, y a des mecs qui font 3 pages là-dessus, chez moi ça fait ½ ligne.
Vous dîtes : « évacuer la sacro-sainte intrigue pour ne retenir que l'écume, les copeaux de l'existence »...
Dans les nouvelles, oui. Enfin... Aujourd'hui, tout le monde l'admet, mais à l'époque ce n'était pas évident. Se sortir de la sacro-sainte intrigue, oui... Et du côté résolutif aussi. Quand on lit du polar, on s'attend toujours à ce qu'à la fin, on explique tout. C'est une contrainte du genre, mais je pense qu'on peut s'en affranchir quand on est dans le cadre de la nouvelle et qu'on est sur un moment beaucoup plus court. On n'a pas besoin d'être résolutif ni d'écrire une histoire comme une espèce de roman en réduction, puisqu'il s'agit plus d'un instantané, comme un polaroid.
J'ai écrit environ 400 nouvelles, donc évidemment je sais comment je vais les aborder aujourd'hui, mais à l'époque j'y allais à tâtons, c'est pour ça que je faisais un peu de roman, un peu de nouvelles, des scénarios aussi.
Vous écrivez encore des scénarios ?
Non, et la télé ne m'intéresse pas. J'avais besoin d'argent à une époque et j'ai fait plusieurs scénarios pour la télévision mais il y a trop d'intermédiaires, on est obligé de parler avec les gens (ironique)... J'aime pas les gens en fait (rires). Parler avec les gens, ça me fatigue un peu, pas parler aux gens comme aujourd'hui, mais avec les gens pour leur expliquer que ce que vous venez de faire, vous l'avez fait parce que c'est vous l'écrivain. Y en a qui comprennent pas, ils estiment que non, alors c'est fatigant, faut toujours se vendre, quoi.
Et les scénarios de BD ?
C'est beaucoup plus facile. Quand on travaille pour la télévision, on a affaire à un producteur, un responsable de fiction qui a toujours 3 assistants, et puis des tas de gens qui s'en mêlent. Les acteurs par exemple. C'est donc extrêmement pénible tout ça. Qui plus est, je n'ai pas été formé pour l'audiovisuel, je n'ai pas l'habitude de refaire 50 fois la même chose. Alors que maintenant, la télévision a inventé une génération de scénaristes qui ne font que ça et sont prêts à refaire autant de fois qu'il le faut le scénario ; ça ne les dérange pas, ils sont payés pour ça.
A un moment donné, je me suis retiré de ce monde là mais en même temps ça me plaisait bien de continuer à travailler le scénario, et comme je suis graphiste au départ, je me suis toujours intéressé à la BD, aux photos, aux images. J'ai donc commencé à travailler un peu par ci par là, avec Loustal, Romain Slocombe, Chauzy...
Et là c'est beaucoup plus simple, pour répondre directement à votre question. Parce que c'est un travail à deux et qu'en face de nous, chez Casterman par exemple, il n'y a qu'une personne. C'est beaucoup plus convivial. Et en plus, on reste dans l'espace du livre, contrairement à ce qui se passe dans l'audiovisuel, où lorsqu'on a terminé le travail d'écriture, l'objet ne vous appartient plus et vous échappe. Quand vous commencez à vous renseigner, « et alors, vous commencez à tourner quand, avec qui... ? », on vous répond « ouais, ouais, bon on vous écrira», et on vous écrit jamais ! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait pas partie des professionnels de la profession : les écrivains, les scénaristes, les gens de l'écrit , ne font pas partie des métiers du cinéma.
Donc, le fait d'être dépossédé est extrêmement frustrant. Et puis un jour, on est devant son écran de télé, à se dire « tiens, ce soir ils passent le fameux film, tu sais celui que j'ai écrit », et puis on se retrouve devant un truc innommable, quoi !
Je reviens sur la longueur des textes, et je vais de nouveau vous citer. Vous dîtes : « Je ne suis plus du tout obsédé par la notion de roman ou de nouvelle ». C’est quelque chose qui vous a tracassé à une époque, la longueur du sacro-saint roman qui doit faire tant de pages ?
Oui. Je me souviens de discussions avec des écrivains qui eux-mêmes disaient ce genre de choses dans les années 80 : un roman, c’est 250 pages ! Alors moi qui n’ai jamais réussi à faire plus de 180 pages, je me suis senti mal parti.
Et je sais aussi que c’est difficile d’éditer un texte avec l’appellation « roman », dans une collection de romans, qui fait moins de 150 pages. C’est le minimum du minimum. Alors moi j’étais toujours dans les minimums ! Mais bon, ça passait.
Maintenant, je ne me prends plus la tête avec ça. Si j’ai une histoire qui mérite d’être développée, je la développe et puis ça va où ça va. Généralement, ça va jusqu’à 100 pages mais au-delà j’ai un peu de mal. Je n’arrive plus à tirer ça vers 160-170 pages comme à une époque, et… je m’en fous complètement ! Après, le problème est d’arriver à le faire éditer, mais jusqu’à présent j’ai publié tous mes manuscrits.
Parlons un peu de votre univers, qui est quand même très sombre. On croise des personnages à la dérive, des junkies, des musiciens déchus, des adolescents en rupture, des personnages qui sont sur le fil du rasoir et qui tombent généralement du mauvais côté. A la rigueur, vous laissez une fin ouverte, ou disons entr’ouverte, avec une lueur d’espoir pour les plus optimistes des lecteurs. Mais, presque toujours, ça finit très mal chez Villard…
En fait, quand je suis passé à la fiction, influencé par la littérature américaine des années 30-40, une littérature engagée, je me suis dit « bon, si j’écris des histoires, ce n’est pas pour dire que tout va bien, que la société est merveilleuse, que c’est vraiment chouette, quoi. » Parce que sinon, ça ne sert à rien d’écrire. Et si on est vraiment dans la joie, vivons pour cette joie et… partons à la plage ! J’écris donc sur ce qui ne va pas. Dans la société, dans mon quotidien, dans ma tête, pour parler finalement du mal. Donc ça finit souvent de manière disons pas tout à fait tragique mais négative. Et puis sur le fond, je suis plutôt quelqu’un d’assez pessimiste, oui…
Et ce que j’essaye d’éviter, c’est le récit d’enquête. Beaucoup de mes collègues, notamment anglo-saxons, ont basé leurs livres sur cela. Alors autant on peut prendre du plaisir à lire ces auteurs, autant moi ça ne m’intéresse pas d’écrire ça.
Les romans de procédure policière, mettre en scène des flics ?
Oui. En 68, j’avais beau être en Allemagne où je faisais mon service militaire, j’étais néanmoins solidaire du mouvement global qui avait lieu en France, et du coup j’ai beaucoup de mal à considérer les policiers comme des héros, voyez-vous… Donc je ne me vois pas écrire des livres où les policiers sont des mecs hyper-sympas, vraiment très sympathiques, contrairement à ceux qu’on rencontre dans les commissariats parisiens.
Et systématiquement, à la fin de ces bouquins, l’ordre règne. Or je n’ai pas du tout cette notion de faire régner l’ordre, et en plus par des policiers assermentés qui gagnent toujours à la fin. On en revient à l’aspect résolutif, cette contrainte du polar. Bon, que les autres le fassent, ça ne me dérange pas, et certains le font très bien. Mais pour moi, en tant qu'écrivain, je n’ai pas envie d’écrire ça.
Vous disiez avoir écrit 400 nouvelles. Vous avez dû acquérir une certaine « gymnastique »…
Une certaine fatigue, surtout… !
…comment elles naissent ces histoires, de quel matériau vous vous servez ?
Alors souvent, quand on me pose cette question, on me dit : « mais alors, comment elle vient l’inspiration ? » (voix de fausset).
Vous êtes dur, j’ai fait exprès de ne pas utiliser ce mot ! Mais je peux jouer le jeu : alors, d’où vous vient l’inssssspiration ?
(Il prend la pose) Ecoutez mon garçon, je vais vous expliquer ! Non, c’est très simple, ça peut venir de n’importe quoi. Tout sert, tous les écrivains répondront la même chose, qu’ils écrivent du noir ou de la blanche d’ailleurs….
Vous êtes peut-être plus sensible aux images ?
A tout. Je peux écouter un disque et retenir une musique qui va m’évoquer des choses par exemple. On parlait de Chet Baker, et je pense à Alone together qui m’a inspiré des textes. Ça peut être des images, des passages de films ou de séries, même si je n’aime pas la série d'ailleurs. Ça peut être des peintures, et des photos bien-sûr. Comme je suis resté lecteur de poésie, ça peut être 2-3 vers… 2-3 verres à boire, aussi !
Oui, tout peut servir, et puis après il faut que tout arrive à se mettre en place, à s’imbriquer, selon un mécanisme qu’on ne peut pas vraiment expliquer. Et la difficulté réside à faire redescendre tout ça dans l’écriture, à arriver à ce que ça tienne la route et que ça fasse l’affaire. Et le meilleur moment dans l’écriture, c’est cette partie de macération. On a une idée, on imagine des trucs, tiens je pourrais lui faire faire ceci ou cela…
Bon, et puis un jour il faut que je m’y mette, alors là ça devient chiant ! Il faut allumer l’ordinateur, je suis tout seul, il pleut… Là on se retrouve confronté à des problèmes d’ordre technique. On a tout dans la tête, et on se coltine avec la technique d’écriture, pour parvenir à ce qu’on veut faire, à ce qu’on avait imaginé, et c’est loin d’être simple.
Vous retravaillez beaucoup vos textes ?
Oui, beaucoup.
Il y a aussi comme une espèce de musicalité, de tempo dans vos textes. Vous écrivez « à l’oreille » ?Est-ce que vous vous relisez, à voix haute, pour savoir si ça « sonne » bien ?
Oui, je dis souvent que j’écris à l’oreille, tout simplement parce que phonétiquement, si ça ne fonctionne pas, je suis partisan – en ce qui me concerne – de changer un mot ou des mots, pour les remplacer par d’autres qui seront peut-être moins justes, mais qui sonnent mieux. J’aime qu’il y ait une fluidité dans le texte. Avec des phrases courtes la plupart du temps, ce qui est aussi lié à une écriture du comportement, qui décrivent surtout ce que font les personnages, plutôt que ce qu'ils pensent.
Passons au jazz, très présent dans vos textes, et je pense d’abord à Cœur sombre. On peut dire que la rencontre entre le jazz et le polar est une rencontre programmée, entre deux genres nés sur le même terreau des déclassés. Le jazz charrie aussi une mythologie – et notamment le destin tragique de nombreux jazzmen – et véhicule des clichés qui servent le roman noir.
La musique est très importante pour moi. Mais pas que le jazz. Le rock, la world music, tout ce qu'on veut... Alors pourquoi j’ai écrit beaucoup plus sur le jazz que sur le rock, ? Ce sont des musiques faites de clichés, de vrais clichés, c'est-à-dire de vraies images. Mais la différence entre les deux, et pour avoir écrit sur les deux, je connais le sujet, c'est que les clichés du rock sont très bas de gamme, on se retrouve tout de suite dans des histoires vraiment sans grand intérêt. Alors que les clichés du jazz sont des clichés de haut niveau. Quand on voit des images de rockers, tiens quand on voit par exemple une photo des Rolling Stones, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces vieux cons, qui s'habillent comme des gosses etc... Ils nous font un peu rire, quoi, ce qui ne veut pas dire que la musique est ridicule, attention ! Bref, tout cela forme une imagerie, une série de clichés, d'histoires qui sont difficiles à dépasser quand on écrit de la fiction là-dessus. Alors qu'il y a dans le jazz – dont les images sont souvent en N&B d'ailleurs – une altitude que le rock n'arrive pas à atteindre. Et ces clichés dont vous parliez – la drogue pour Art Pepper, la mort de Chet Baker, Monk qui s'enferme dans sa folie... - ça a de la gueule, quoi ! Et je me suis dit, tant qu'à écrire sur des musiciens, autant que ce soit du jazz ; on hausse ainsi le niveau de l'écrit.
Alors pourquoi des musiciens, c'est tout simplement parce que je suis dans un domaine polar à contrainte et que je ne suis pas du tout intéressé, comme je vous le disais, par les policiers et la vie des bêtes... Alors il y a cette figure de musicien, un marginal sans être trop marginalisé non plus, quelqu'un de libre, de créatif, un personnage intéressant que j'utilise donc assez souvent.
Un court passage de Coeur sombre, sur Art Pepper, tiens...[lecture, p. 30, « Pepper, hein ?... »]
Oui, je parle beaucoup d'Art Pepper dans ce livre parce que je crois qu'il a écrit certainement le plus roman noir sur le jazz, qui est son autobiographie tout simplement, ça s'appelle Straight Life, du titre d'un de ses morceaux fétiches. C'est une vie infernale, de junkie, où on a l'impression que son quotidien n'est fait que de recherche d'argent, de came, de femmes, de prison. Il sort du pénitencier, il braque des supérettes... Et puis en même temps il a une certaine « pêche » et il parle très peu de la musique. On a l'impression qu'il a été enregistrer un disque pour se faire un peu de fric, quoi. Et c'était un grand, grand musicien. Magnifique livre.
Vous vous amusez aussi avec les destins de jazzmen connus...
J'ai fait beaucoup ça pour Jazzman, comme j'ai ces 10000 signes à rédiger tous les mois. C'est très difficile de tout inventer, alors je me suis dit pourquoi ne pas emprunter dans la biographie de certains des moments que je passerai ensuite à la moulinette de la fiction, sans tout déformer non plus.
Vous imaginez par exemple que Chet Baker a mis en scène son propre suicide...
Oui, mais c'est pas dans Jazzman, sinon je me serais fait engueuler ! [il s'agit de la nouvelle intitulée « Lady C. », dans le recueil Made in Taïwan ; coll. Rivages/Noir]
Bref, sa mort a toujours posé un problème, puisqu'on ne sait pas s'il est tombé, s'il s'est suicidé ou s'il a été tué. [Chet Baker a été retrouvé mort à Amsterdam le 13 mai 1988, sur le trottoir devant son hôtel, après avoir « chuté » de son balcon]. Je suis parti de là et j'ai écrit une nouvelle complètement improbable, en imaginant que Chet, devant de l'argent à quelqu'un, a trouvé un clochard lui ressemblant, l'a tué et a disparu. Pour réapparaître à Cuba, en train de jouer de la salsa dans le groupe de Ruben Gonzalez.
Une petite anecdote, à propos : une année, j'étais au salon du livre à Paris, et y a un type qui s'approche et me dit « Vous êtes Marc Villard, vous ? Ce que vous avez fait à Chet Baker, ça n'a pas de nom ! » Le gars m'a carrément engueulé, et j'étais en train de me justifier, alors qu'il fallait rien dire en fait, il finit par me dire « Non, non, et c'était le dernier livre de Marc Villard que je lisais. Au revoir. », et sur ces mots, il s'en va !
Un ami m'a confié dernièrement : « oh dis donc jazz et polar, ça fait un peu truc d'initiés, quand même... ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le jazz est quand même perçu comme une musique assez « intellectualisante ».
Quant au polar, c'est un genre qui a beaucoup gagné en respectabilité ces dernières années, il n'y a qu'à regarder les chiffres de vente, les articles de presse, le nombre de collections, pour constater que c'est un genre en vogue. Comment percevez-vous cette évolution ?
En ce qui concerne le jazz, moi je suis d'accord avec votre ami. Le bon côté, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout se procurer, tout écouter, du bop, du dixieland et j'en passe... Pour ma part, je suis plus porté vers un jazz mélodique on dira, qu'il soit des années 50 ou d'aujourd'hui, avec Petrucciani, Aldo Romano, Eddy Louiss ou d'autres. Alors il faut passer un peu de temps à écouter ce qui se fait, ou ce qui se fait pas mais ce qu'on aime.
Pour ce qui est du polar, y a comme un quiproquo. Quand on regarde par exemple la liste des meilleurs ventes, on s'aperçoit que sur les 20 premières, il y a bon an mal an un livre ressortissant au genre noir. Pas mal d'américains bien-sûr, des scandinaves maintenant, et puis Fred Vargas qui arrive à se caser, un Guillaume Musso, Chattam... Seulement, ces auteurs là, hormis Vargas que je mets à part, sont répertoriés sous l'appellation « polar » mais ils font à vrai dire ce que j'appellerais du « thriller international » qui peut être lu partout dans le monde. Et qui sont conçus par des hommes de marketing et racontent toujours un peu les mêmes histoires, des enquêtes à n'en plus finir, des histoires de curés qui datent de Mathusalem, ... Avec Dan Brown d'ailleurs, le côté « sacré » a pénétré en force dans le polar, qui n'était à priori pas fait pour ça.
Ce sont des arbres qui masquent la forêt. Vous avez ces 10 livres toutes les semaines, avec souvent les mêmes auteurs. Derrière, on trouve des auteurs américains qui vendent pas mal, comme Ellroy ou Lehane ; et là déjà on est dans du costaud, et ce n'est plus du polar mais du roman noir, du grand roman noir. Et en dessous, y a tous les autres, des français, des italiens, des espagnols, qui vendent moins. Et tout à la fin, vous avez les... nouvellistes noirs, comme moi ! Qui vendent encore moins, et qui se situent juste avant les poètes !
En termes économiques, ces thrillers internationaux pèsent sacrément leur poids et du coup, la critique se dit « allez, le boulot a été fait , ça roule, ça se vend bien... » Mais c'est faux. Vous en avez 10 chaque semaine qui se vendent très bien mais les autres se vendent pas si bien que ça. Et chez les libraires, c'est un peu la même chose. Je suis passé à la FNAC des Halles hier, y a un rayon polar c'est n'importe quoi ! Ils alignent, vous savez, tous ces bouquins dont je viens de parler, plus les gens qui sont plus mauvais qu'eux mais qui font la même chose ! Vous avez un mur, comme ça, immense, avec tous ces livres à plat, des nullités affligeantes, parce que c'est de l'argent. Et ils se disent après tout, le polar ça marche, pourquoi on en profiterait pas, hein ?
Et tous les autres, qui font du roman noir, de la nouvelle, qui sont dans le constat social, qui ressemblent un peu à ce qui se faisait au départ, ce dont je parlais au début avec Hammett et d'autres, eh bien ceux-là faut aller les chercher...
Le fait est que c'est comme ça. Ce sont deux mondes qui de façon arbitraire ont été placés sous la même appellation, qui se côtoient vaguement mais qui n'ont rien à voir. Alors qui restera au bout du compte dans 30, 40, 50 ans quand on sera tous morts ? Je ne sais pas.
[public] Vous vivez de votre plume ?
Non, avant, j'avais un job, j'ai bossé 40 ans, comme tout le monde. Mais je peux peut-être répondre à la place de mes collègues. Ils font des ateliers d'écriture par exemple. Chose qui, personnellement, m'indiffère complètement : je ne vois pas pourquoi on va apprendre à des gens à écrire alors que déjà on est trop nombreux ! (hilare). Non, au-delà de ça, on peut se demander si c'est vraiment moral de laisser entendre à des gens, souvent des enfants, qu'ils sont des écrivains, qu'ils vont pouvoir y arriver. Enfin, ça me pose un problème. Bref, j'ai aussi des copains comme Caryl Ferey par exemple qui font de petites pièces pour France Culture. Ça paye bien. Et puis il y a aussi les résidences d'écrivains.
Bref, on est sans arrêt sur la route, la vie familiale est compliquée, c'est pas facile, et il faut un certain courage et beaucoup d'abnégation.
En tout cas, c'eut été une erreur pour quelqu'un comme moi, qui suis plutôt anxieux, mais pour des gens qu'ont la forme, pourquoi pas... Et puis en même temps, est-ce qu'on écrit plus parce qu'on a plus de temps ? J'en suis pas convaincu. J'ai pas le sentiment d 'écrire plus depuis que j'ai cessé mon travail. Et ce n'est pas le but de l'opération... et il faut aussi avoir envie d'écrire. Admettons que vous soyez écrivain à plein temps, le mythe total..., alors tous les matins en vous levant vous vous dites « Bon, va falloir que j'écrive » ! En tout cas, ça me gênerait d'avoir à me prouver à moi-même que je suis un écrivain. Je n'ai pas besoin de le prouver, je m'en fous.
Je vais m'arrêter ici et laisser la, parole au public, que je remercie au passage de s'être déplacé, et surtout par cette belle journée !
Je voudrais parler un peu de Barbès, qui occupe une grande place dans vos textes, avec une espèce d'effet d'attirance/répulsion Je voudrais savoir ce qui vous lie autant à Barbès.
J'ai habité plusieurs fois dans le 18ème arrondissement, que je connais bien. C'est un quartier qui produit de la fiction, comme on dit. C'est-à-dire qu'en se baladant dans les rues, on n'a pas à se prendre la tête pour savoir ce qu'on pourrait raconter, ce qu'on pourrait planter comme histoire... Tout est sous la main, en quelque sorte. Et puis je suis un écrivain très urbain, très parisien, je suis complètement quelqu'un de la ville. Et d'ailleurs, quand je voyage, je ne vais que dans des villes, j'ai horreur d'aller à la campagne. Le vert, tout ce vert... ça me fait mal au coeur !
Alors la répulsion, oui... Mais quand on est dans des quartiers avec de la misère, de l'immigration, de la drogue, de la violence, on ne sait pas trop comment en parler. On ne va pas être trop compassionnel, mais on ne peut pas non plus tout laisser passer. Donc j'essaye d'être un peu entre les deux, j'essaye d'être honnête.
Vos textes ont une dimension sociale, mais vous considérez-vous comme un écrivain engagé ?
Je pense que le fait de parler plutôt de Barbès que du 16ème arrondissement, c'est une façon de s'engager. Parler plutôt de musiciens dans la panade que de flics qui se portent bien, c'est être engagé aussi. J'ai aussi écrit beaucoup de nouvelles sur les sans-papiers, par exemple. Mais je ne me revendique pas pour autant comme un écrivain engagé.
On trouve des personnages qu'on n'a pas l'habitude de croiser tant que ça ailleurs...
C'est ça la forme d'engagement. Maintenant, je pars du principe qu'un livre n'est pas un tract politique. Alors je ne me mets pas d'un seul coup, au prétexte que je suis à Barbès, à parler de la condition lamentable dans laquelle sont laissées les prostituées de la rue Myrha ou d'ailleurs. J'écris des fictions qui se suffisent à elles-mêmes, au lecteur après de choisir son chemin, de prendre parti, de se faire son opinion. Mais je n'en dis pas plus qu'il ne faut ; je ne veux pas juger..
On finira donc sur ces mots. Merci beaucoup !
Un mot sur l'actualité éditoriale de Marc Villard :
Il fait partie des 19 auteurs ayant signé une nouvelle "rock et noire" dans le recueil London calling, qui vient de paraître aux éditions Buchet-Chastel, un hommage à l'album éponyme des Clash.
Dans quelques mois sortira l'adaptation BD - par Jean-Philippe Peyraud - de sa novella Bird.
Enfin, ceux qui se rendent au festival de Lamballe, le week-end prochain, auront l'occasion de le rencontrer.
 Le lac des singes, second roman de Marcus Malte - paru au Fleuve noir en 1997 et épuisé - vient d'être réédité en Folio policier.
Le lac des singes, second roman de Marcus Malte - paru au Fleuve noir en 1997 et épuisé - vient d'être réédité en Folio policier.




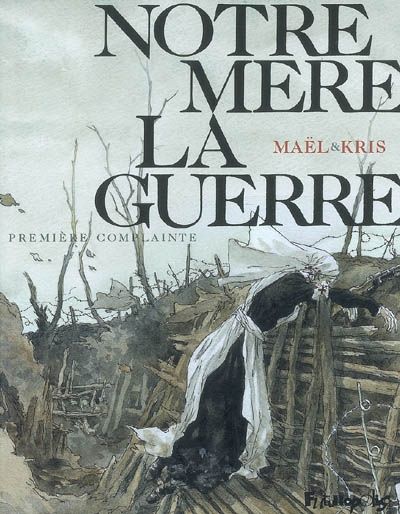 Hiver 1915. La guerre s'enlise dans les tranchées, les combats font rage. Un poilu, en creusant une ancienne galerie, tombe sur le cadavre... d'une femme. Elle s'appelait Joséphine Taillandier et travaillait comme serveuse dans une auberge située non loin de là. Quelques jours avant, elle avait eu une prise de bec avec un Poilu. Ni une ni deux, le suspect idéal a fini au peloton.
Hiver 1915. La guerre s'enlise dans les tranchées, les combats font rage. Un poilu, en creusant une ancienne galerie, tombe sur le cadavre... d'une femme. Elle s'appelait Joséphine Taillandier et travaillait comme serveuse dans une auberge située non loin de là. Quelques jours avant, elle avait eu une prise de bec avec un Poilu. Ni une ni deux, le suspect idéal a fini au peloton.
 David Sears a grandi sous la coupe d'un père schizophrène et dans l'ombre d'une soeur surdouée. Avocat dans une petite ville, il mène aujourd'hui une vie paisible auprès de sa femme et de sa fille Patty, 15 ans.
David Sears a grandi sous la coupe d'un père schizophrène et dans l'ombre d'une soeur surdouée. Avocat dans une petite ville, il mène aujourd'hui une vie paisible auprès de sa femme et de sa fille Patty, 15 ans.
 Après un an de "séchoir", Max vient d'être libéré et retrouve les copains. Une sacrée bande de truands et de loulous parigots.
Après un an de "séchoir", Max vient d'être libéré et retrouve les copains. Une sacrée bande de truands et de loulous parigots.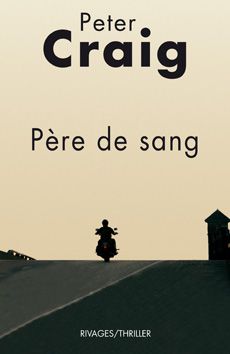 Lydia, 17 ans, a fugué quand elle en avait 14 et vit depuis d'expédients de copines friquées. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, c'est bien connu, et on fait de mauvaises rencontres, comme celle avec Jonah Pincerna, un agent immobilier un peu particulier qui met à disposition de la mafia des "maisons-entrepôts" pour faire transiter de grandes quantités de drogue ou d'argent. Lors d'une expédition punitive, alors qu'il pousse Lydia au meurtre, celle-ci retourne l'arme contre lui et s'enfuit.
Lydia, 17 ans, a fugué quand elle en avait 14 et vit depuis d'expédients de copines friquées. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, c'est bien connu, et on fait de mauvaises rencontres, comme celle avec Jonah Pincerna, un agent immobilier un peu particulier qui met à disposition de la mafia des "maisons-entrepôts" pour faire transiter de grandes quantités de drogue ou d'argent. Lors d'une expédition punitive, alors qu'il pousse Lydia au meurtre, celle-ci retourne l'arme contre lui et s'enfuit.
 Un intrus s'est glissé malgré tout dans ce tableau idyllique : un voyeur qui observe depuis des semaines leur manège amoureux, fasciné par Martha. Candide, gracile et fragile Martha, fixant des heures durant un point sur l'océan et peut-être l'ombre de quelque drame enfoui. Sa présence et l'intrusion d'un rôdeur amorcent le drame à venir.
Un intrus s'est glissé malgré tout dans ce tableau idyllique : un voyeur qui observe depuis des semaines leur manège amoureux, fasciné par Martha. Candide, gracile et fragile Martha, fixant des heures durant un point sur l'océan et peut-être l'ombre de quelque drame enfoui. Sa présence et l'intrusion d'un rôdeur amorcent le drame à venir. Depuis plus de vingt ans, Doc Stoeger est rédacteur du (seul) journal de Carmel city, petite bourgade où, à son grand désespoir, il ne se passe jamais rien.
Depuis plus de vingt ans, Doc Stoeger est rédacteur du (seul) journal de Carmel city, petite bourgade où, à son grand désespoir, il ne se passe jamais rien.