Comme tant d'autres dans o'quartier, Gennaro vit de petits trafics jusqu'au jour où, convoqué par le boss Don Rafele, sa vie prend une autre tournure. Trafics, meurtres, torture : Gennaro n'est pas taillé pour ça - "moi je voulais seulement gagner ma vie."
 L'ambition de De Filippo n'est pas d'explorer les arcanes de la Camorra, à la manière d'un Roberto Saviano, ni de raconter l'ascension d'un jeune homme dans la hiérarchie mafieuse, mais de montrer comment "le Système" s'empare de lui, le soumet, assèche ses émotions, et combien cet homme, en définitive, interagit avec son milieu.
L'ambition de De Filippo n'est pas d'explorer les arcanes de la Camorra, à la manière d'un Roberto Saviano, ni de raconter l'ascension d'un jeune homme dans la hiérarchie mafieuse, mais de montrer comment "le Système" s'empare de lui, le soumet, assèche ses émotions, et combien cet homme, en définitive, interagit avec son milieu.Ce milieu, c'est un quartier populaire de Naples, où l'ont vit de magouilles et les uns sur les autres dans des logements vétustes, "une enclave dedans la ville. Et après y' avait la ville, avec d'autres gens, d'autres règles, la loi, les immeubles normaux, il y avait l'université, l'école... la mer". Un terrain fertile et une main d'oeuvre inépuisable pour la mafia. Cette réalité, Gennaro ne la perçoit que confusément ("je ne comprends rien" répète-il plusieurs fois au cours de son récit) et même, ne se considère pas véritablement comme un camorriste avant que sa femme, excédée, ne lui ouvre les yeux.
A ce moment, la conscience alourdie par la mort d'un gosse ou l'innocence bafouée d'une pute, en proie au doute et à la culpabilité, il a encore le choix : se sauver ou devenir un autre Paolino, ce "fou criminel" qui l'a pris sous son aile. Mais comment déserrer l'étau de la Camorra ? Le dénouement, un peu faible, laisse entendre que la famille et l'amour des siens suffiront. Optimisme discutable.
L'ambition (réussie) de l'auteur passe aussi par la langue, une narration à la première personne*, dans un mélange d'italien et d'argot napolitain (excellemment rendu dans la traduction) : De Filippo se glisse habilement dans la peau de son personnage, sans qu'on voit jamais son ombre, ou presque. Tout ce que nous voyons, nous le voyons à travers le regard de Gennaro. C'est à travers, et seulement à travers sa parole que le lecteur suit et reconstitue les événements, en s'arrangeant des digressions, des ellipses voire des moments de confusion du narrateur.
C'est aussi à travers Gennaro que l'auteur nous montre comment la camorra, cette séculaire et prospère organisation, a élargi ses activités à l'international (drogue, prostitution) et investi dans des secteurs légaux (l'immobilier, par exemple). Comment elle a atteint un tel degré de toxicité : en charge de la gestion des déchets, elle pollue les sols et la baie de Naples, comme elle pollue les consciences. Comment elle a infesté les institutions et comment rien d'important ne se décide sans elle.
Pire : ce que laisse entrevoir L'Offense, c'est que la Camorra, de bien des manières, est l'institution. La norme. C'est sans doute ce qui effraie le plus, plus encore que l'extrême violence dont elle use pour asseoir son pouvoir.
L'Offense / Francesco De Filippo (Sfregio, 2006, trad. de l'italien par Serge Quadruppani. Métailié, Noir, 2011)
* le premier roman de l'auteur traduit en français, Le naufrageur, utilise le même procédé narratif et raconte sensiblement la même histoire - un jeune albanais se retrouve sous les ordres d'un chef de la mafia.




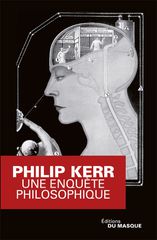 Toutes deux "ont ceci de commun qu'elles partent du principe qu'il y a une vérité à découvrir. Notre activité est faite d'indices qu'il nous faut l'un comme l'autre rassembler pour reconstruire une image vraie de la réalité. Au coeur de nos entreprises respectives, il y a la recherche d'un sens, d'une vérité qui, pour une raison ou pour une autre, est demeurée cachée."
Toutes deux "ont ceci de commun qu'elles partent du principe qu'il y a une vérité à découvrir. Notre activité est faite d'indices qu'il nous faut l'un comme l'autre rassembler pour reconstruire une image vraie de la réalité. Au coeur de nos entreprises respectives, il y a la recherche d'un sens, d'une vérité qui, pour une raison ou pour une autre, est demeurée cachée."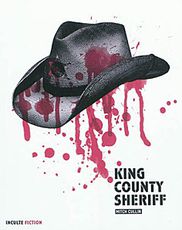 Adossé contre le puits d'où monte une supplique (Papa, mes jambes ne bougent plus !), dans cette clairière envahie de broussailles, près de cette cabane en ruine qui fut la maison de son enfance, le brave et apprécié de tous shériff Branches soliloque.
Adossé contre le puits d'où monte une supplique (Papa, mes jambes ne bougent plus !), dans cette clairière envahie de broussailles, près de cette cabane en ruine qui fut la maison de son enfance, le brave et apprécié de tous shériff Branches soliloque.  Faisons court : août 2005, l'ouragan Katrina dévaste La Nouvelle-Orléans et ses environs. En plein chaos, Robicheaux est chargé de retrouver deux jeunes Noirs ayant cambriolé un caïd local et impliqués par ailleurs dans une affaire de viol.
Faisons court : août 2005, l'ouragan Katrina dévaste La Nouvelle-Orléans et ses environs. En plein chaos, Robicheaux est chargé de retrouver deux jeunes Noirs ayant cambriolé un caïd local et impliqués par ailleurs dans une affaire de viol.  Moins subversif qu'impertinent, Apportez-moi (la tête d') Octavio Paz ne se prive cependant pas de pourfendre la corruption institutionnalisée et les connivences entre police, justice et médias.
Moins subversif qu'impertinent, Apportez-moi (la tête d') Octavio Paz ne se prive cependant pas de pourfendre la corruption institutionnalisée et les connivences entre police, justice et médias. Nous baladant d'un bout à l'autre du Cap, Roger Smith donne à voir une ville contrastée - entre affluence touristique et recrudescence des gangs -, s'attardant particulièrement sur la zone des "Flats", un gigantesque township s'étendant sur la plaine à l'est du Cap où se déploient une misère et une violence extrêmes.
Nous baladant d'un bout à l'autre du Cap, Roger Smith donne à voir une ville contrastée - entre affluence touristique et recrudescence des gangs -, s'attardant particulièrement sur la zone des "Flats", un gigantesque township s'étendant sur la plaine à l'est du Cap où se déploient une misère et une violence extrêmes.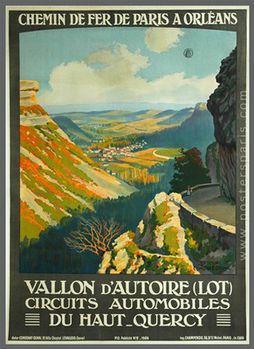
 Où on fait connaissance avec Johann Friedrich von Allmen, gentilhomme suisse et rentier ruiné, collectionneur d'art et chapardeur à ses heures, amateur d'opéra et d'orchidées (comme Nero Wolfe, le détective de Rex Stout), lecteur compulsif (notamment d'Elmore Leonard, référence qui tranche dans ce décor compassé). En deux mots : un indécrottable snob, et tout l'opposé de son fidèle serviteur guatémaltais, Carlos.
Où on fait connaissance avec Johann Friedrich von Allmen, gentilhomme suisse et rentier ruiné, collectionneur d'art et chapardeur à ses heures, amateur d'opéra et d'orchidées (comme Nero Wolfe, le détective de Rex Stout), lecteur compulsif (notamment d'Elmore Leonard, référence qui tranche dans ce décor compassé). En deux mots : un indécrottable snob, et tout l'opposé de son fidèle serviteur guatémaltais, Carlos.
 A commencer par la figure du muckracker*, un reporter judiciaire nommé Zsigmond Gordon, rentré au pays après quelques années passées à... Chicago. Alors qu'ont lieu en grandes pompes les obsèques du Premier Ministre Gyula Gömbös, lui s'intéresse à l'assassinat d'une jeune prostituée juive et décide d'enquêter. Son obstination lui vaudra évidemment quelques désagréments, menaces voilées et contusions, avant de le ramener finalement vers les ors du pouvoir.
A commencer par la figure du muckracker*, un reporter judiciaire nommé Zsigmond Gordon, rentré au pays après quelques années passées à... Chicago. Alors qu'ont lieu en grandes pompes les obsèques du Premier Ministre Gyula Gömbös, lui s'intéresse à l'assassinat d'une jeune prostituée juive et décide d'enquêter. Son obstination lui vaudra évidemment quelques désagréments, menaces voilées et contusions, avant de le ramener finalement vers les ors du pouvoir.