On l'attendait de pied ferme, ce "quatre mains" de Dominique Manotti et DOA. Parfois pour de mauvaises raisons, spéculant sur leurs divergences politiques, omettant un peu vite leur proximité sur le plan du style - concis, rapide - et des thèmes - les arcanes et les turpitudes du pouvoir.
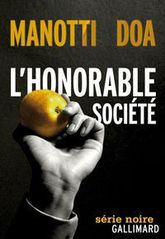 Un commandant de police détaché au Commissariat de l'Energie Atomique flingué par deux barbouzes, durant un cambriolage. Le chef de groupe Pâris, un ancien de la Brigade financière "promu" au 36 pour excès de zèle, hérite de l'affaire.
Un commandant de police détaché au Commissariat de l'Energie Atomique flingué par deux barbouzes, durant un cambriolage. Le chef de groupe Pâris, un ancien de la Brigade financière "promu" au 36 pour excès de zèle, hérite de l'affaire.
En ligne de mire : un groupuscule de jeunes radicaux écologistes. Coupables idéaux, écran de fumée, enquête savamment orientée.
En coulisses : un ex-correspondant de guerre qui veut tirer sa fille du guêpier, la patronne du leader français du BTP, un candidat à l'élection présidentielle. Ministre en exercice, colérique et populiste, aux amitiés douteuses. A quelques jours du sacre scrutin, la pression est énorme. Pas de vagues, surtout.
L'enjeu, colossal : la privatisation d'un fleuron de l'industrie nationale, ou comment partager le gâteau public entre amis...
Evidemment, toute ressemblance avec des personnes et des situations existantes...*
Proche de Nos fantastiques années fric par sa structure et son sujet (mais doté de personnages moins ambigus, moins "charnus" à mon sens), L'honorable société nous fait pénétrer, au gré d'une intrigue rigoureusement élaborée et menée tambour battant, les officines agitées du pouvoir, donnant à voir les collusions nocives entre le monde politique et celui des affaires, et la façon dont une poignée d'individus se sert de l'Etat à des fins personnelles.
Une affaire d'Etat en pleine effervescence électorale, où sont à l'oeuvre stratégies de communication - du storytelling à la désinformation pure et simple -, contrôle à distance des médias, combat des chefs, rôle occulte des proches conseillers, canaux officieux, manoeuvres en sous-main, fuites dans la presse savamment orchestrées...
L'honorable société est au départ un projet de scénario. Ça se sent, pourrait-on dire, à lire cette prose sèche et souvent descriptive, mais ce serait oublier qu'elle est déjà à l'oeuvre dans leurs précédents romans.
Trompeuse aussi l'apparente simplicité de la langue. Très travaillée, dosée, excellement maîtrisée dans la gestion du ryhme et de la tension narrative.
(Un peu de grammaire ?)
"Pâris gare sa voiture quelques dizaine de mètres plus loin. Besoin de réfléchir. Il allume une cigarette, peste contre lui-même d'avoir repiqué à la nicotine si facilement. L'anglais chez Scoarnec. Il fait sa propre enquête, je n'ai pas su gagner sa confiance, mauvais signe. Il va ressortir à tous les coups, pour aller où ? Comment a t-il trouvé cette adresse ? Qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas ?"
Un juxtaposition de phrases nominales, interrogatives, injonctives, comme de soudains mouvements de caméra. Tandis que le recours fréquent à l'infinitif induit une sorte d'objectivité dans la façon de narrer les événements, une froideur tempérée par l'alternance, sur de courtes séquences, entre le discours direct et indirect, entre les différents points de vue, neutre, omniscient, subjectif.
Sensation d'être à la fois tenu à distance et pleinement dans l'action et aux côtés des personnages. Une "bonne distance", qui permet notamment aux auteurs de ne pas verser dans l'enquête documentaire, la caricature ou le pamphlet.
Pour ce qui est de l'exercice un peu futile d'essayer de repérer les coutures - qui a (ré)écrit tel passage, qui a introduit tel rebondissement, qui préparait le café ? -, bien malin celui qui y parvient. Il y a du Manotti (précise), il y a du DOA (plus musclé), et leur travail commun est à la hauteur des espérances.
L'espérance ? Elle se fait rare ici. Vision pessimiste, renvoyant dos à dos révolutionnaires d'opérette et tueurs mandatés par le pouvoir, droite cynique et gauche vélléitaire. Chacun des acteurs de cette sinistre farce finira d'ailleurs par trahir son prochain ou simplement abdiquer, transiger, et sauvegarder ce qui peut l'être. Chacun pour soi et Dieu-sait-qui pour tous. Les ambitions individuelles ont dévoré tout cru l'élan collectif.
Ils sont peu en France à emprunter la voie de la politique-fiction (citons tout de même Jean-Hugues Oppel ou Jérôme Leroy). En s'accaparant ces sujets, notamment la consanguinité fric/pouvoir, en les mettant en perspective, en les passant au crible de la fiction, DOA et Manotti livrent un polar de premier choix, susceptible, sinon d'éveiller les consciences, du moins de maintenir éveillé et de nourrir l'esprit critique.
Ouvrez les yeux, éteignez vos télés !, disait le slogan... Et lisez.
L'honorable société / DOA, Dominique Manotti (Gallimard, Série Noire, 2011)
*Pilotées par l'Elysée, les tractations se poursuivent toujours entre l'Etat et les grands groupes que sont Areva, Alstom et Bouygues, en vue de créer le champion nucléaire français qu'appelle de ses voeux le Président de la République.
 Macabre, malsain, dérangeant... Premiers mots qui viennent à l'esprit, en lisant cette dizaine de nouvelles peuplées de détraqués - pédophiles, assassins, violeurs, cannibales et autres philantropes.
Macabre, malsain, dérangeant... Premiers mots qui viennent à l'esprit, en lisant cette dizaine de nouvelles peuplées de détraqués - pédophiles, assassins, violeurs, cannibales et autres philantropes. 



 "Qui peut bien connaître l'âme humaine ?" se demande l'un des personnages. Qu'est-ce qui pousse ainsi le Dr Fähner, après quarante ans de vie commune, à tuer sauvagement son épouse ? Et ce gardien de musée, d'où lui vient cette obsession pour cette statue ? Pourquoi ce jeune homme ne peut-il s'empêcher de tuer et d'énucléer les moutons de son village ? Cet homme qui a tué froidement ses agresseurs n'a t-il pas fait preuve d'une violence disproportionnée ?
"Qui peut bien connaître l'âme humaine ?" se demande l'un des personnages. Qu'est-ce qui pousse ainsi le Dr Fähner, après quarante ans de vie commune, à tuer sauvagement son épouse ? Et ce gardien de musée, d'où lui vient cette obsession pour cette statue ? Pourquoi ce jeune homme ne peut-il s'empêcher de tuer et d'énucléer les moutons de son village ? Cet homme qui a tué froidement ses agresseurs n'a t-il pas fait preuve d'une violence disproportionnée ? Son amant/dealer passé sous un camion, Lola se met à la colle avec Le Grécos, le genre dangereux et prêt à tout pour se faire du fric. Lola et sa gueule d'ange de la désolation, une junkie de 15 piges échappée de sa cité comme un prédateur de sa cage.
Son amant/dealer passé sous un camion, Lola se met à la colle avec Le Grécos, le genre dangereux et prêt à tout pour se faire du fric. Lola et sa gueule d'ange de la désolation, une junkie de 15 piges échappée de sa cité comme un prédateur de sa cage. Ultime héritier d'une honorable famille du Mississipi, Jack Branch est devenu enseignant, comme son père avant lui. En cette année 1954, il dispense à ses élèves un cours thématique sur l'histoire du Mal.
Ultime héritier d'une honorable famille du Mississipi, Jack Branch est devenu enseignant, comme son père avant lui. En cette année 1954, il dispense à ses élèves un cours thématique sur l'histoire du Mal. Un auteur de best-sellers catégorie thriller (sic) et sa femme s'en vont passer quelques jours au chalet familial. Caser les enfants, souffler, se "retrouver". Et pour lui, retrouver l'inspiration - son super-espion est pour l'heure coincé en plein désert marocain, et son éditeur commence à s'impatienter - d'où quelques digressions assez cocasses à propos du marché de l'édition.
Un auteur de best-sellers catégorie thriller (sic) et sa femme s'en vont passer quelques jours au chalet familial. Caser les enfants, souffler, se "retrouver". Et pour lui, retrouver l'inspiration - son super-espion est pour l'heure coincé en plein désert marocain, et son éditeur commence à s'impatienter - d'où quelques digressions assez cocasses à propos du marché de l'édition. Dans la famille braqueurs de banque, demandez le chauffeur. Lennon est un vrai pro, un perfectionniste qui prépare minutieusement ses itinéraires et ses plans de fuite.
Dans la famille braqueurs de banque, demandez le chauffeur. Lennon est un vrai pro, un perfectionniste qui prépare minutieusement ses itinéraires et ses plans de fuite. Eva Einarsdottir, récemment rentrée en Islande à la suite d'une déception amoureuse, se fait prêter un appartement par une vague connaissance new-yorkaise. L'appartement, situé en haut d'une tour, est immense, luxueux et doté d'un système de surveillance high-tech. Dans la chambre, un mystérieux masque est creusé dans l'un des murs. Dans l'immeuble, des voisins bizarres ou envahissants.
Eva Einarsdottir, récemment rentrée en Islande à la suite d'une déception amoureuse, se fait prêter un appartement par une vague connaissance new-yorkaise. L'appartement, situé en haut d'une tour, est immense, luxueux et doté d'un système de surveillance high-tech. Dans la chambre, un mystérieux masque est creusé dans l'un des murs. Dans l'immeuble, des voisins bizarres ou envahissants.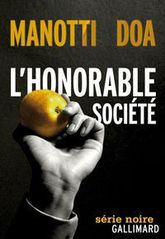 Un commandant de police détaché au Commissariat de l'Energie Atomique flingué par deux barbouzes, durant un cambriolage. Le chef de groupe Pâris, un ancien de la Brigade financière "promu" au 36 pour excès de zèle, hérite de l'affaire.
Un commandant de police détaché au Commissariat de l'Energie Atomique flingué par deux barbouzes, durant un cambriolage. Le chef de groupe Pâris, un ancien de la Brigade financière "promu" au 36 pour excès de zèle, hérite de l'affaire. Culiacán, capitale de l'Etat de Sinaloa, au nord-ouest du pays. Bruno Canizalez, fils d'un éminent homme politique et avocat prometteur, est retrouvé mort, tué d'une balle en argent. Quelques heures plus tard, sa maîtresse se suicide.
Culiacán, capitale de l'Etat de Sinaloa, au nord-ouest du pays. Bruno Canizalez, fils d'un éminent homme politique et avocat prometteur, est retrouvé mort, tué d'une balle en argent. Quelques heures plus tard, sa maîtresse se suicide. Golgotha, soit le chemin de croix de Lagarto, un vieux flic de Scasso, un quartier pauvre et violent en périphérie de Buenos Aires.
Golgotha, soit le chemin de croix de Lagarto, un vieux flic de Scasso, un quartier pauvre et violent en périphérie de Buenos Aires.