Comme tant d'autres dans o'quartier, Gennaro vit de petits trafics jusqu'au jour où, convoqué par le boss Don Rafele, sa vie prend une autre tournure. Trafics, meurtres, torture : Gennaro n'est pas taillé pour ça - "moi je voulais seulement gagner ma vie."
 L'ambition de De Filippo n'est pas d'explorer les arcanes de la Camorra, à la manière d'un Roberto Saviano, ni de raconter l'ascension d'un jeune homme dans la hiérarchie mafieuse, mais de montrer comment "le Système" s'empare de lui, le soumet, assèche ses émotions, et combien cet homme, en définitive, interagit avec son milieu.
L'ambition de De Filippo n'est pas d'explorer les arcanes de la Camorra, à la manière d'un Roberto Saviano, ni de raconter l'ascension d'un jeune homme dans la hiérarchie mafieuse, mais de montrer comment "le Système" s'empare de lui, le soumet, assèche ses émotions, et combien cet homme, en définitive, interagit avec son milieu.Ce milieu, c'est un quartier populaire de Naples, où l'ont vit de magouilles et les uns sur les autres dans des logements vétustes, "une enclave dedans la ville. Et après y' avait la ville, avec d'autres gens, d'autres règles, la loi, les immeubles normaux, il y avait l'université, l'école... la mer". Un terrain fertile et une main d'oeuvre inépuisable pour la mafia. Cette réalité, Gennaro ne la perçoit que confusément ("je ne comprends rien" répète-il plusieurs fois au cours de son récit) et même, ne se considère pas véritablement comme un camorriste avant que sa femme, excédée, ne lui ouvre les yeux.
A ce moment, la conscience alourdie par la mort d'un gosse ou l'innocence bafouée d'une pute, en proie au doute et à la culpabilité, il a encore le choix : se sauver ou devenir un autre Paolino, ce "fou criminel" qui l'a pris sous son aile. Mais comment déserrer l'étau de la Camorra ? Le dénouement, un peu faible, laisse entendre que la famille et l'amour des siens suffiront. Optimisme discutable.
L'ambition (réussie) de l'auteur passe aussi par la langue, une narration à la première personne*, dans un mélange d'italien et d'argot napolitain (excellemment rendu dans la traduction) : De Filippo se glisse habilement dans la peau de son personnage, sans qu'on voit jamais son ombre, ou presque. Tout ce que nous voyons, nous le voyons à travers le regard de Gennaro. C'est à travers, et seulement à travers sa parole que le lecteur suit et reconstitue les événements, en s'arrangeant des digressions, des ellipses voire des moments de confusion du narrateur.
C'est aussi à travers Gennaro que l'auteur nous montre comment la camorra, cette séculaire et prospère organisation, a élargi ses activités à l'international (drogue, prostitution) et investi dans des secteurs légaux (l'immobilier, par exemple). Comment elle a atteint un tel degré de toxicité : en charge de la gestion des déchets, elle pollue les sols et la baie de Naples, comme elle pollue les consciences. Comment elle a infesté les institutions et comment rien d'important ne se décide sans elle.
Pire : ce que laisse entrevoir L'Offense, c'est que la Camorra, de bien des manières, est l'institution. La norme. C'est sans doute ce qui effraie le plus, plus encore que l'extrême violence dont elle use pour asseoir son pouvoir.
L'Offense / Francesco De Filippo (Sfregio, 2006, trad. de l'italien par Serge Quadruppani. Métailié, Noir, 2011)
* le premier roman de l'auteur traduit en français, Le naufrageur, utilise le même procédé narratif et raconte sensiblement la même histoire - un jeune albanais se retrouve sous les ordres d'un chef de la mafia.




 Suite à l'assassinat de son ami et collègue Dantini, Lupo, un policier chevonné des Affaires internes, enquête discrètement sur une bande de flics ripoux de la brigade anti-terroriste, à la solde du "Commandant", homme d'influence et stratège d'une guerre perpétuelle contre les homosexuels, les arabes, les Noirs, les droits-de-l'hommiste et tutti quanti. Autant d'obstacles à la suprématie de la race blanche et de la civilisation occidentale.
Suite à l'assassinat de son ami et collègue Dantini, Lupo, un policier chevonné des Affaires internes, enquête discrètement sur une bande de flics ripoux de la brigade anti-terroriste, à la solde du "Commandant", homme d'influence et stratège d'une guerre perpétuelle contre les homosexuels, les arabes, les Noirs, les droits-de-l'hommiste et tutti quanti. Autant d'obstacles à la suprématie de la race blanche et de la civilisation occidentale.  Moins sinueux, moins ambitieux peut-être, Le père et l'étranger me semble néanmoins plus harmonieux, en tout cas plus abouti. Un court et beau roman sur l'altérité.
Moins sinueux, moins ambitieux peut-être, Le père et l'étranger me semble néanmoins plus harmonieux, en tout cas plus abouti. Un court et beau roman sur l'altérité. En s'aréveillant ce matin-là, le commissaire Salvo Montalbano découvre sur la plage devant chez lui... un cheval mort. La bête, couverte de sang, a été cruellement battue à coups de barres de fer. Le temps d'appeler ses collègues, la carcasse a disparu !
En s'aréveillant ce matin-là, le commissaire Salvo Montalbano découvre sur la plage devant chez lui... un cheval mort. La bête, couverte de sang, a été cruellement battue à coups de barres de fer. Le temps d'appeler ses collègues, la carcasse a disparu ! "Evidemment, Huston n'était pas son nom. Puisqu'il était dépourvu d'un nom dont il pût tirer vanité, Huston s'était donné son nom tout seul après avoir vu un vieux film de John Huston, Le Faucon maltais, un film des années 40 qui lui avait paru être le plus beau film qu'il eût jamais vu ou qu'il verrait jamais. L'alchimie produite par la photo en noir et blanc, par le jeu entre Humphrey Bogart, Sydney Greenstreet et Peter Lorre et par le sentiment de défaite, de perte inéluctable qu'on tirait de l'intrigue, l'avait à ce point fasciné qu'il en était comme imprégné et que l'on en retrouvait des traces dans ses livres, fréquemment situés dans le milieu des perdants et dans les années quarante."
"Evidemment, Huston n'était pas son nom. Puisqu'il était dépourvu d'un nom dont il pût tirer vanité, Huston s'était donné son nom tout seul après avoir vu un vieux film de John Huston, Le Faucon maltais, un film des années 40 qui lui avait paru être le plus beau film qu'il eût jamais vu ou qu'il verrait jamais. L'alchimie produite par la photo en noir et blanc, par le jeu entre Humphrey Bogart, Sydney Greenstreet et Peter Lorre et par le sentiment de défaite, de perte inéluctable qu'on tirait de l'intrigue, l'avait à ce point fasciné qu'il en était comme imprégné et que l'on en retrouvait des traces dans ses livres, fréquemment situés dans le milieu des perdants et dans les années quarante." Randazzo, la trentaine plus ou moins célibataire, est issu d'une famille bourgeoise - un père ancien député de gauche, qui "avec le massacre de l'opération Mains propres (...) a réussi à traverser l'océan de merde en restant propre" - aurait pu être rentier ou haut-fonctionnaire, mais il a choisi d'être flic. Pas par vocation, mais plutôt par un concours de circonstances, un concours d'inspecteur en l'occurence. Pour le moment, ça lui convient, il verra plus tard si...
Randazzo, la trentaine plus ou moins célibataire, est issu d'une famille bourgeoise - un père ancien député de gauche, qui "avec le massacre de l'opération Mains propres (...) a réussi à traverser l'océan de merde en restant propre" - aurait pu être rentier ou haut-fonctionnaire, mais il a choisi d'être flic. Pas par vocation, mais plutôt par un concours de circonstances, un concours d'inspecteur en l'occurence. Pour le moment, ça lui convient, il verra plus tard si...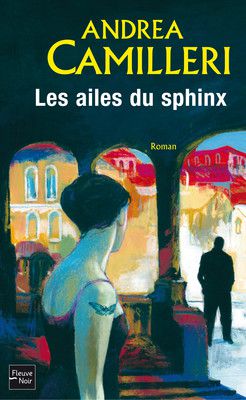 "Mais où donc étaient passés ces petits matins quand, à peine aréveillé, on se sentait traversé d'une espèce de courant de bonheur pur, sans motif ?" se demande t-il. Le poids des ans s'apitoie Montalbano n°1. Foutaises répond Montalbano n°2,
"Mais où donc étaient passés ces petits matins quand, à peine aréveillé, on se sentait traversé d'une espèce de courant de bonheur pur, sans motif ?" se demande t-il. Le poids des ans s'apitoie Montalbano n°1. Foutaises répond Montalbano n°2,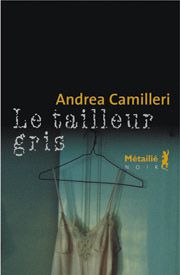 Comme le démontre ici Camilleri qui délaisse sa verve coutumière et son dialecte "montalbanesque" pour nous introduire, avec une langue dépouillée, toute en effleurements, dans le cocon douillet d'une maison bourgeoise, où règne la même sobriété et la même retenue.
Comme le démontre ici Camilleri qui délaisse sa verve coutumière et son dialecte "montalbanesque" pour nous introduire, avec une langue dépouillée, toute en effleurements, dans le cocon douillet d'une maison bourgeoise, où règne la même sobriété et la même retenue.
 Sur ordre de sa chère et tendre Livia, Montalbano a dû dénicher en catastrophe une villa en bord de mer pour un couple d'amis et leur jeune (et insupportable) garçon. Mission réussie, sauf que les incidents vont se multiplier, entre l'invasion de cafards puis de souris, la disparition soudaine de l'enfant et, finalement, la découverte d'un cadavre dans le sous-sol "caché" de la maison (sport national en Sicile : dissimuler un étage lors d'une construction pour contourner un permis de construire trop restrictif, et entamer ensuite une procédure de régularisation !).
Sur ordre de sa chère et tendre Livia, Montalbano a dû dénicher en catastrophe une villa en bord de mer pour un couple d'amis et leur jeune (et insupportable) garçon. Mission réussie, sauf que les incidents vont se multiplier, entre l'invasion de cafards puis de souris, la disparition soudaine de l'enfant et, finalement, la découverte d'un cadavre dans le sous-sol "caché" de la maison (sport national en Sicile : dissimuler un étage lors d'une construction pour contourner un permis de construire trop restrictif, et entamer ensuite une procédure de régularisation !). Derrière le paravent n'est pas vraiment une nouveauté : inédit en France, il est paru en Italie il y a une trentaine d'années déjà.
Derrière le paravent n'est pas vraiment une nouveauté : inédit en France, il est paru en Italie il y a une trentaine d'années déjà.