Californie, années 50. Depuis la mort de leurs parents, Lora King et son frère Bill sont très proches, la jeune enseignante bon chic bon genre et le policier intègre vivent d'ailleurs sous le même toit. Jusqu'au jour où Bill tombe amoureux et se marie avec l'énigmatique et pétillante Alice Steele, ancienne costumière pour le cinéma. A la fois troublée et fascinée, Lora tente d'en découvrir plus sur sa belle-soeur et les douteux personnages qui gravitent autour d'elle.
Premier roman de Megan Abbott - mais le troisième publié en France -, Red Room Lounge apparaît comme un canevas dont Absente et Adieu Gloria seraient les prolongements, des variations autour d'un même motif : revisiter, à partir d'une perspective féminine, l'univers symbolique et formel du film noir américain des années 40/50.
Chez Abbott, la femme ne se caractérise plus par rapport à son homologue masculin (qu'il soit flic, gangster, amant...), mais constitue désormais le centre de gravité du récit. Ainsi elle n'est plus seulement un objet de convoitise, de perte ou de récompense, mais existe par elle-même, gagne en complexité et en nuances, quand bien même elle continue d'obéir à un archétype (tentatrice, salvatrice ou victime expiatoire). Quant au "mâle", il est relégué le plus souvent à l'arrière-plan et réduit à une fonction, Bill occupant dans le cas présent celle de l'homme intègre et droit abîmé par une passion amoureuse.
On retrouve par ailleurs cette esthétique du film noir propre à tous ses romans : décor urbain, jeu d'ombres et de lumières, caméra subjective (ici le récit adopte uniquement le point de vue de Lora), personnages rattrapés par un passé trouble, à l'instar d'Alice, dont la nouvelle vie de femme au foyer dévouée et d'épouse respectable va être mise à mal.
 Mettant en scène deux rivales se disputant les faveurs d'un homme, l'ingénue et la sulfureuse, la garce et l'oie blanche, Megan Abbott va peu à peu brouiller les rôles, déployant son récit dans cette zone indistincte et mouvante séparant le vice et la vertu, le monde policé de Lora et le monde interlope d'Alice. Lentement, les contrastes s'atténuent, les masques glissent, les certitudes morales s'effritent.
Mettant en scène deux rivales se disputant les faveurs d'un homme, l'ingénue et la sulfureuse, la garce et l'oie blanche, Megan Abbott va peu à peu brouiller les rôles, déployant son récit dans cette zone indistincte et mouvante séparant le vice et la vertu, le monde policé de Lora et le monde interlope d'Alice. Lentement, les contrastes s'atténuent, les masques glissent, les certitudes morales s'effritent.
Soucieuse de protéger son frère contre l'influence néfaste - du moins le croit-elle - d'Alice, et afin d'étayer ses soupçons, Lora enquête et tente de relier les indices (les changements d'humeur d'Alice, les sous-entendus d'une de ses anciennes connaissances, l'irruption d'un mystérieux inconnu...). Mais ses tentatives pour interpréter les "signes" resteront vaines : non seulement elle a une vision tronquée des événements (1), mais elle se heurte, seule et impuissante, à un monde illisible, chaotique et gouverné par les passions (2). Dans ce monde, la loi et l'ordre, incarnées par Bill, n'ont pas voix au chapitre.
D'ailleurs le dénouement ne distinguera ni coupables ni victimes, ne dévoilera aucune vérité intangible, seulement un enchevêtrement d'existences désordonnées aux trajectoires capricieuses. Une fois les apparences levées, on verra au passage se dissoudre le modèle social dominant - la middle-class prospère des années 50 dans sa banlieue résidentielle proprette - ainsi que le rêve hollywoodien, machine à broyer les starlettes où cohabitent le strass et le sordide - prostitution, chantage, corruption.
A l'inverse d'Absente et d'Adieu Gloria qui offraient davantage de "prises" au lecteur (3), Red Room Lounge présente des angles moins saillants, son relief est moins accidenté et il ne s'y passe finalement pas grand-chose, du moins en surface. L'intrigue suit un cours souterrain, et repose presque entièrement (hormis la légère accélération finale) sur l'ambiguïté des personnages, l'ambiance feutrée et la tension sourde que l'auteure, avec beaucoup de finesse, presque imperceptiblement, instille peu à peu : aussi le frou-frou des étoffes, le tintement des verres et la saveur des mets, les joyeuses réceptions, tous ces plaisirs insouciants qui égrènent le récit, annoncent-ils à leur façon le désastre à venir.
Du coup, certains s'ennuieront sans doute, sevrés d'action et de rebondissements. Moins tranchant que les romans ultérieurs, Red Room Lounge me semble néanmoins plus riche, et susceptible de laisser un souvenir plus vivace.
Red Room Lounge / Megan Abbott (Die a Little, 2005, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch. Ed. du Masque, 2011)
(2) c'est un thème majeur du roman noir américain de l'après-guerre, qui place souvent un individu désarmé face à un monde qu'il ne comprend pas, et luttant désespérément avant d'être anéanti.
(3) les circonstances de la mort de Jean Spangler (Absente) ou le violent affrontement entre les deux protagonistes d'Adieu Gloria sont des éléments plus tangibles, plus spectaculaires et davantage à même de retenir l'attention du lecteur.





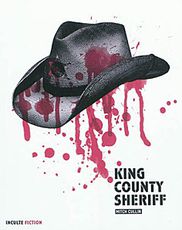 Adossé contre le puits d'où monte une supplique (Papa, mes jambes ne bougent plus !), dans cette clairière envahie de broussailles, près de cette cabane en ruine qui fut la maison de son enfance, le brave et apprécié de tous shériff Branches soliloque.
Adossé contre le puits d'où monte une supplique (Papa, mes jambes ne bougent plus !), dans cette clairière envahie de broussailles, près de cette cabane en ruine qui fut la maison de son enfance, le brave et apprécié de tous shériff Branches soliloque.  Faisons court : août 2005, l'ouragan Katrina dévaste La Nouvelle-Orléans et ses environs. En plein chaos, Robicheaux est chargé de retrouver deux jeunes Noirs ayant cambriolé un caïd local et impliqués par ailleurs dans une affaire de viol.
Faisons court : août 2005, l'ouragan Katrina dévaste La Nouvelle-Orléans et ses environs. En plein chaos, Robicheaux est chargé de retrouver deux jeunes Noirs ayant cambriolé un caïd local et impliqués par ailleurs dans une affaire de viol. 
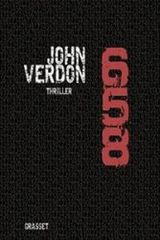 Pour le reste, John Verdon nous sert l'éternelle soupe liophylisée du thriller arôme serial killer : le duel entre un psychopathe machiavélique à l'enfance traumatisante et un flic légendaire marqué par un drame familial.
Pour le reste, John Verdon nous sert l'éternelle soupe liophylisée du thriller arôme serial killer : le duel entre un psychopathe machiavélique à l'enfance traumatisante et un flic légendaire marqué par un drame familial. L'histoire, c'est celle de Chris Flynn, qui a force de multiplier les conneries, se retrouve dans un centre de détention pour mineurs, au grand dam de ses parents, des blancs de la classe moyenne. On le retrouve quelques années plus tard, en train de bosser dans la petite entreprise familiale, "Les Sols fabuleux de Flynn".
L'histoire, c'est celle de Chris Flynn, qui a force de multiplier les conneries, se retrouve dans un centre de détention pour mineurs, au grand dam de ses parents, des blancs de la classe moyenne. On le retrouve quelques années plus tard, en train de bosser dans la petite entreprise familiale, "Les Sols fabuleux de Flynn". Jupe en tweed et corsage blanc, elle (narratrice anonyme) est comptable dans un club de seconde zone et s'ennuie fermement. Jusqu'au jour où la sublime et glaciale Gloria la remarque et entreprend de faire son éducation.
Jupe en tweed et corsage blanc, elle (narratrice anonyme) est comptable dans un club de seconde zone et s'ennuie fermement. Jusqu'au jour où la sublime et glaciale Gloria la remarque et entreprend de faire son éducation. L'histoire est simple et rassemble
L'histoire est simple et rassemble  Ultime héritier d'une honorable famille du Mississipi, Jack Branch est devenu enseignant, comme son père avant lui. En cette année 1954, il dispense à ses élèves un cours thématique sur l'histoire du Mal.
Ultime héritier d'une honorable famille du Mississipi, Jack Branch est devenu enseignant, comme son père avant lui. En cette année 1954, il dispense à ses élèves un cours thématique sur l'histoire du Mal.