Tout commence avec la mort du petit Rogelio. Accident domestique ou infanticide ? Moqué par la presse, le commandant Ojeda s'empresse d'accuser la mère de l'enfant, dont la fragilité l'émeut par ailleurs, et lui donne l'idée d'écrire le grand roman dont il rêve depuis toujours. Non content de piller Pessoa, Flaubert ou Garcia Marquez, il décide tout bonnement, pour l'aider dans son entreprise, de faire kidnapper le poète mexicain et Prix Nobel de littérature Octavio Paz...
 Moins subversif qu'impertinent, Apportez-moi (la tête d') Octavio Paz ne se prive cependant pas de pourfendre la corruption institutionnalisée et les connivences entre police, justice et médias.
Moins subversif qu'impertinent, Apportez-moi (la tête d') Octavio Paz ne se prive cependant pas de pourfendre la corruption institutionnalisée et les connivences entre police, justice et médias.
Flics, avocats, journalistes, tous pataugent dans la même fosse à purin, torturant, falsifiant les preuves, fabriquant des coupables ou chassant le scoop juteux. Tournées en dérision, poussées jusqu'à l'absurde, leurs manigances et leur cupidité confinent au ridicule.
Tout n'est qu'imposture et leurre au Mexique de Federico Vite, y compris l'éminent Octavio Paz (un autre représentant de l'ordre établi, des Lettres celui-là), réduit ici au rôle d'un tartuffe s'octroyant indûment les mérites d'autrui et dont la fourberie n'a d'égal que son immense renommée.
Pour avoir osé déboulonner la statue du Commandeur, tous les exemplaires de Fisuras en el continente literario ont d'ailleurs été retirés des librairies mexicaines, sur la demande de la veuve du poète.
Pour finir, si ce bref roman (une centaine de pages) donne parfois l'impression d'une accumulation de scènes successives - mention spéciale à l'invasion d'un commissariat par une meute de chats ! -, ce n'est pas une raison suffisante pour se priver de cette mignardise, drôle et délicieusement caustique.
Conseil(s) d'accompagnement : dans Une saison de scorpions (chez le même éditeur), Bernardo Fernandez utilise sensiblement le même registre burlesque pour traiter des travers de la société mexicaine.
Apportez-moi Octavio Paz / Federico Vite (Fisuras en el continente literario, 2006, trad. de l'espagnol (Mexique) par Tania Campos. Moisson Rouge, 2011)




 Dans la chaleur tropicale de Puerto Vallarta, un village de pêcheurs situé sur la côté occidentale du Mexique et réquisitionné pour l'occasion, la tension et l'animosité entre les acteurs sont si fortes que John Huston a offert à chacun d'eux un pistolet en or et cinq balles d'argent gravées à leur nom (l'anecdote est avérée). L'ennui, c'est qu'une des balles est retrouvée dans un type tout ce qu'il y a de plus mort, forçant ainsi Sunny à descendre de son tabouret de bar.
Dans la chaleur tropicale de Puerto Vallarta, un village de pêcheurs situé sur la côté occidentale du Mexique et réquisitionné pour l'occasion, la tension et l'animosité entre les acteurs sont si fortes que John Huston a offert à chacun d'eux un pistolet en or et cinq balles d'argent gravées à leur nom (l'anecdote est avérée). L'ennui, c'est qu'une des balles est retrouvée dans un type tout ce qu'il y a de plus mort, forçant ainsi Sunny à descendre de son tabouret de bar. Culiacán, capitale de l'Etat de Sinaloa, au nord-ouest du pays. Bruno Canizalez, fils d'un éminent homme politique et avocat prometteur, est retrouvé mort, tué d'une balle en argent. Quelques heures plus tard, sa maîtresse se suicide.
Culiacán, capitale de l'Etat de Sinaloa, au nord-ouest du pays. Bruno Canizalez, fils d'un éminent homme politique et avocat prometteur, est retrouvé mort, tué d'une balle en argent. Quelques heures plus tard, sa maîtresse se suicide. Golgotha, soit le chemin de croix de Lagarto, un vieux flic de Scasso, un quartier pauvre et violent en périphérie de Buenos Aires.
Golgotha, soit le chemin de croix de Lagarto, un vieux flic de Scasso, un quartier pauvre et violent en périphérie de Buenos Aires. Genaro, ancien conducteur de métro à Buenos Aires licencié suite à la privatisation de la ligne, et Haroldo, un ex-marin, s'apprêtent à prendre la "Trochita", ce petit train argentin qui parcourt sans relâche et à faible allure la Patagonie sur des milliers de kilomètres.
Genaro, ancien conducteur de métro à Buenos Aires licencié suite à la privatisation de la ligne, et Haroldo, un ex-marin, s'apprêtent à prendre la "Trochita", ce petit train argentin qui parcourt sans relâche et à faible allure la Patagonie sur des milliers de kilomètres.
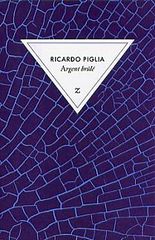 C'est l'histoire d'un braquage et des événements qui ont suivi. Septembre 1965 : une bande de gangsters attaquent un fourgon blindé dans la banlieue de Buenos Aires. Ils tuent plusieurs hommes et volent plus d'un demi-million de dollars avant de se réfugier en Uruguay. Le 05 novembre, l'appartement qu'ils occupent à Montevideo est encerclé par des centaines de policiers. Le siège - plutôt le bain de sang - va durer plus de 15 heures.
C'est l'histoire d'un braquage et des événements qui ont suivi. Septembre 1965 : une bande de gangsters attaquent un fourgon blindé dans la banlieue de Buenos Aires. Ils tuent plusieurs hommes et volent plus d'un demi-million de dollars avant de se réfugier en Uruguay. Le 05 novembre, l'appartement qu'ils occupent à Montevideo est encerclé par des centaines de policiers. Le siège - plutôt le bain de sang - va durer plus de 15 heures. Pas facile d'être un flic intègre à Buenos Aires sous le régime Videla, alors que les militaires contrôlent le pays et pourchassent, torturent et assassinent sans vergogne des milliers d'opposants politiques. Nous sommes en Argentine à la fin des années 70 et la "guerre sale" bat son plein.
Pas facile d'être un flic intègre à Buenos Aires sous le régime Videla, alors que les militaires contrôlent le pays et pourchassent, torturent et assassinent sans vergogne des milliers d'opposants politiques. Nous sommes en Argentine à la fin des années 70 et la "guerre sale" bat son plein. En cette année 1889, alors que l'Exposition universelle s'apprête à ouvrir ses portes, les plus grands détectives du monde, accompagnés de leur assistant, se réunissent à Paris.
En cette année 1889, alors que l'Exposition universelle s'apprête à ouvrir ses portes, les plus grands détectives du monde, accompagnés de leur assistant, se réunissent à Paris. A
A